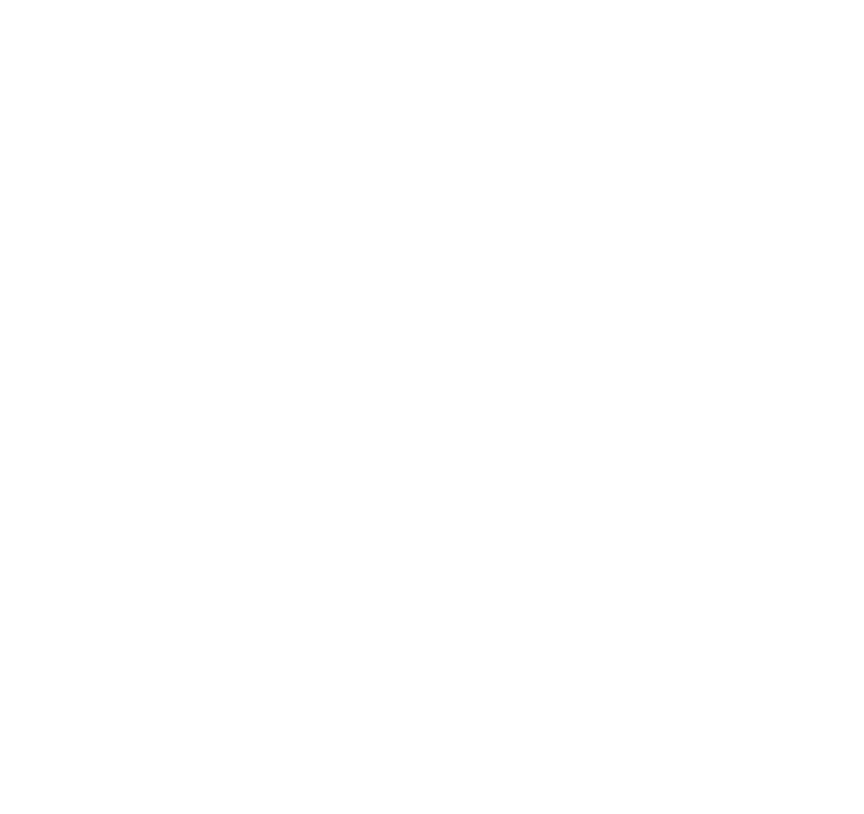Laure Abouaf– APPROCHE(S) – VILLES D’EUROPEAPPROCHE(S)-2017-2018

Les signes qui permettraient d’identifier les villes d’Europe traversées par Laure Abouaf sont très rares et équivoques sitôt qu’on pense les avoir dénichés. Le nom de ces localités n’est pas indiqué sous la forme d’une légende qui nous obligerait à rechercher dans nos souvenirs de voyage ce que, de toutes façons, nous ne retrouverions pas à l’intérieur du cadre photographique. En effet, à l’opposé de la carte postale ou du reportage touristique, la série exclut de son champ de visée la couleur locale, le détail typique, la note exotique, le cadre pittoresque ou l’ambiance folklorique. Pour autant, l’absence des procédés usuels de mise en valeur de ces scènes urbaines et leur anonymat lui-même, ne les rendent pas énigmatiques. Ces lieux photographiques sont, d’une certaine façon, des lieux communs en ce sens qu’ils apparaissent similaires – et non pas semblables – à d’autres que nous rencontrons dans la vie ordinaire. Cette similarité cultivée signifie qu’ils appartiennent moins à un espace géographique précis qu’au regard de la photographe.
La mise entre parenthèses de la géolocalisation dans ces photographies ne tient pas, comme on pourrait le croire, à une insuffisance de détails qui priverait le spectateur d’indices pertinents pour reconnaître les lieux de prises de vue, mais au contraire à un excès de réalité qui oriente son attention vers autre chose. Par exemple, un excès de présence accordé à des sujets qui ne suscitent pas d’ordinaire l’admiration, comme le sas d’un tapis-bagage dans un aéroport dont la forme transcende la banalité de l’objet. Plus fréquemment, la dominance de la couleur attire l’attention sur elle plutôt que sur le lieu public. La sombre grisaille d’une avenue se clarifie de la traînée jaune d’un trolleybus qui la traverse. Un bleu de nuit inonde les façades d’un immeuble et, mêlant sa couleur aux lumières des becs-de-gaz, projette un halo fluorescent sur le visage d’une passante. L’excès de réalité se manifeste aussi par les jeux graphiques des encadrements de fenêtres, des palissades, des échafaudages ou des barres d’appui du métro qui s’imposent de façon prioritaire dans la scène urbaine. Pour ces raisons, la matière signifiante de l’image s’affirme comme un élément central de cette série et toute curiosité relative aux lieux des prises de vue devient alors superfétatoire.
Les photographies de Laure Abouaf, bien qu’elles différent du genre du paysage urbain, et même de la photographie de rue dont l’une des caractéristiques est la présence humaine, restent fortement liées cependant à l’espace urbain qu’elles explorent de façon inaccoutumée. Elles proposent des hiérarchies visuelles qui ne correspondent pas à celles que construisent, de façon constante et triviale, nos perceptions de la réalité. On pourrait expliquer cette différence une fois pour toutes par l’argument paresseux qui consiste à opposer la vision de l’artiste au simple phénomène de la vue, quand l’une et l’autre s’appliquent à des sujets identiques. Mais si l’on prend au sérieux la mise à l’écart des noms de lieux voulue par la photographe, on est amené à penser que cette œuvre érige un monde parallèle au notre et que l’espace photographique qu’elle dévoile met en question la notion même de l’espace. Nous savons que cette dernière notion a connu une évolution dans l’histoire et que la perception que l’homme a du monde a considérablement varié au cours des siècles : le monde clos du Moyen-Age, découpé en espaces sacrés et profanes, diffère profondément du monde rationnalisé des Lumières qui découvre un espace infini. Il ne fait aucun doute que, dans cette histoire, la photographie a modifié sensiblement la notion commune que nous avons de l’espace, entendu comme le milieu dans lequel se situe l’ensemble de nos perceptions.
Ainsi, en regardant ce que nous ne voyons pas, Laure Abouaf opère des coupes dans notre espace quotidien et produit des prises de vue qui, à leur manière, relèvent d’une sourde sacralisation.