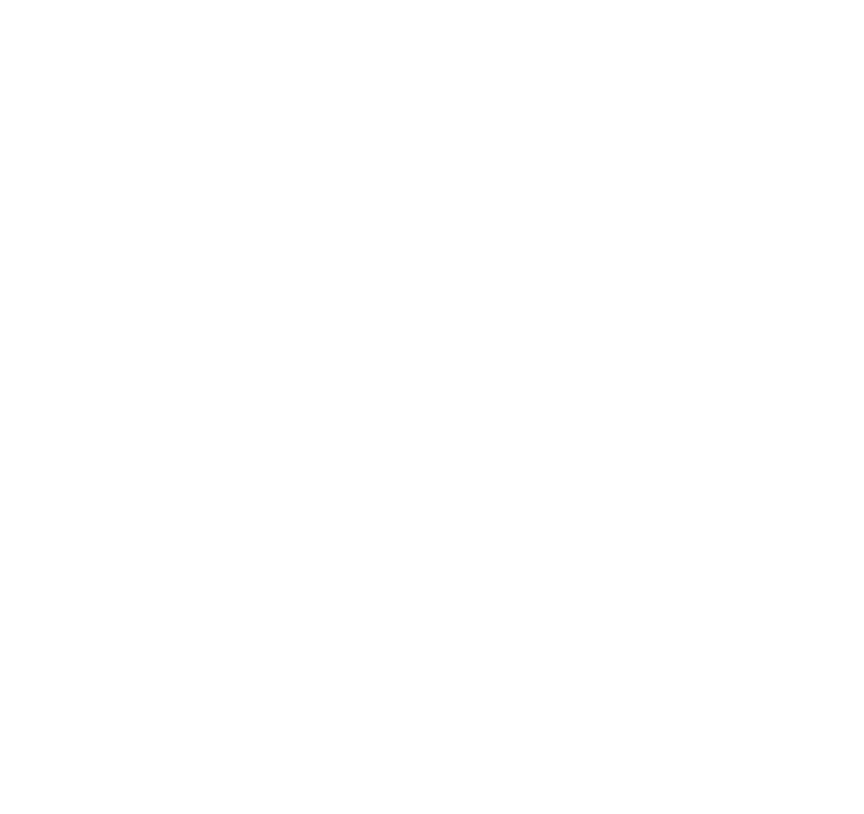Annabel Aoun Blanco– ELOIGNE-MOI DE TOI (Exposition au Musée Réattu d’Arles) (Avril-novembre 2019)

Constituée par des séries de photographies et de vidéos, l’œuvre d’Annabel Aoun Blanco est structurée en trois épisodes comportant chacun des chapitres, ou pour reprendre la terminologie de l’artiste, en trois boucles divisées elles-mêmes en cycles. L’exposition du Musée Réattu présente un choix de réalisations extraites des cycles de la première partie de cette œuvre considérable dont l’architecture circulaire et tripartite s’articule sur une idée platonicienne relative au Temps. Le philosophe considérait, en effet, (Cf. Timée, 37d-38a) le temps comme une imitation de l’éternité indivisible, se déroulant en cercle selon les modalités du passé, du présent et du futur. La référence au texte de Platon n’est ni une fioriture, ni un faire-valoir, elle constitue un fil conducteur dans l’évolution du travail et justifie, par analogie, le recours aux moyens mis en œuvre, l’image fixe et l’image animée.
La totalité de l’œuvre se présente comme une méditation plastique consacrée à l’épreuve du temps et tout particulièrement à celle du temps vécu à travers l’expérience de la mémoire et de l’oubli. La forme méditative des séries se caractérise par une concentration sur le sujet récurent qui s’offre à la contemplation, la figure humaine. Parfois des torses ou des corps, mais surtout des visages. Ces effigies s’apparentent au portrait par leur forme mais s’en distinguent radicalement par leur fonction car l’artiste ne cherche pas à reproduire ou à interpréter les traits caractéristiques de personnages particuliers. Ce qui apparaît dans le cadre photographique ou dans l’intermittence d’une séquence vidéographique ressemble plutôt à des faciès détériorés, aussi imprécis que des empreintes, livides ainsi que des moulages, impressionnants dans leur expression comme des mascarons et attirants par l’énigme qu’ils recèlent, comme s’ils illustraient de façon littérale la célèbre pensée de Pascal : Un portrait porte absence et présence, plaisir et déplaisir (Pascal, Pensée 678, Ed Brunschvicg). Par là même, les modèles qui ont servi à réaliser ces portraits semblent plus imaginaires que réels, ce sont des masques rappelant tour à tour des spectres, des momies, des simulacres, des fantômes en fonction du traitement subi avant les prises de vue. En fait, les formes qui se manifestent sous ces aspects, dans de grands formats photographiques ou dans les clignements des scènes filmées, sont des figurations de l’image-souvenir.
Tout le projet d’Annabel Aoun Blanco se concentre, en effet, sur le devenir de l’image-souvenir, les étapes successives de sa reviviscence et de ses altérations, son fragile maintien dans la mémoire, sa visibilité incertaine en dépit des efforts de focalisation, son immatérialité intenable, son évanescence et son dépérissement et puis sa mort dans l’irréversible du temps. Le dispositif plastique mis en œuvre accomplit une approche phénoménologique du souvenir, la photographie ou la vidéo rapportant, selon un régime de visibilité variable, les impressions fugitives saisies lors des actes de remémoration. Pour y parvenir de façon pratique, le tour de force consistait à rendre les médiums visuels – communément estimés comme fidèles à la réalité – capables de placer des spectateurs face à des réminiscences, à ces objets aériens et fantomatiques que sont les souvenirs. Il suffit de suivre l’élaboration de quelques images du Cycle 1 pour voir se révéler l’intention de l’auteure dans son appropriation du médium photographique.
Dans la première série du Cycle 1 intitulée En Suspens, six modèles sont photographiés en buste dans une attitude et une expression commune : bras croisés comprimant leur poitrine, yeux grand ouverts, des rougeurs sur leur visage au bord de l’asphyxie. Les corps sont immergés dans une eau claire et saisis au moment de leur épuisement vital. Cette série marque une distance, et quasiment une scission, avec le genre du portrait auquel on serait cependant conduit à la rapporter in extremis puisqu’après tout elle se donne la figure humaine comme principal objet. Mais d’une part, le dispositif de mise en scène supprime toute relation de regard réciproque entre le modèle et la photographe et d’autre part, il empêche le sujet d’attendre une quelconque valorisation de lui-même en adoptant la pose qui lui conviendrait. Il ne reste plus que l’image d’une personne au plus près de la mort, pas tout à fait elle-même et pas tout à fait une autre. Ce décalage avec l’usage ordinaire du portrait permet à Annabel Aoun Blanco de poser les linéaments de son projet : photographier des figures qui stagnent dans une identité inquiète entre l’être et le néant. Cette ambivalence est comprise dans la polysémie de l’expression En Suspens, titre de la série, qui évoque à la fois le sentiment d’attente angoissée des modèles, l’interruption de leur apparoir naturel et l’incertitude qui envahit le spectateur face à la limite où se tiennent les modèles, entre la vie et la mort.
Dans les séries suivantes, les procédés de prise de vue accentuent davantage la transformation des sujets en images surréelles. Avec Avatars, la mise en scène de six visages photographiés dans un cadrage de photographie d’identité échappe complètement aux codes qui régissent ces représentations officielles. Les sujets installés de face derrière une vitre chargée de buée transparaissent en flou, les yeux convulsés et la mine hagarde. Seuls quelques pourtours de la face prennent de la netteté par une intervention de l’artiste qui a laissé glisser son doigt sur la surface vitreuse opacifiée par la condensation. Il ne s’agit plus de portraits d’identité, mais de faciès non identifiés, presque cadavériques dans la couleur rosâtre dominante. Un autre agencement de mise en scène, visible dans l’image La Sirène et dans la série Danse Contemporaine II, consiste à immerger partiellement les modèles dans du lait. Dans cette dernière série, la blancheur du liquide, celles de la baignoire et du mur de fond abolissent les repères de l’espace où évoluent ces corps de femmes dans une gestuelle qui semble incompréhensible. Il ne reste plus alors que des fragments de corps flottants, semblables à des ombres disloquées.
Les cinq premières séries du Cycle 1 sont les seules qui soient réalisées avec des modèles vivants. A partir de la sixième série, Annabel Aoun Blanco, tout en conservant la couleur, privilégie les gammes de gris et ne photographie que des empreintes ou des masques. Ce changement de procédé poursuit la stratégie entreprise avec les soustractions successives qu’elle avait infligées au réalisme de la représentation des modèles vivants. L’introduction du noir et blanc dans les cycles est marquée par le titre provocateur de la sixième série, Le Mandylion, nom donné au voile sur lequel le visage de Jésus aurait été imprimé de façon miraculeuse avant sa mort. Ce stratagème a pour but l’interrogation du spectateur sur cette identification de la photographie à l’une des figures de la Sainte Face de manière à ce que l’examen des similitudes apporte un éclairage sur le champ de visibilité que l’artiste s’impose. D’une part, en effet, Le Mandylion religieux et Le Mandylion photographique occupent chacun une première place : la relique est considérée par l’Eglise orthodoxe comme la première icône de l’iconographie religieuse chrétienne et la série photographique est, de fait, la première réalisée en noir et blanc. Ensuite, par son aspect sacré, Le Mandylion s’oppose à toute autre représentation d’un visage comme les photographies s’opposent au genre usuel du portrait. Enfin, l’idée d’au-delà liée à la figure du divin n’est pas sans rapport avec l’objet suprasensible visé par la photographie, l’image mémorielle.
A propos de cette œuvre, il est intéressant de connaître le mode de production des images. Les neuf photographies qui constituent la série ont pour objet des moulages en creux pratiqués directement sur des modèles vivants. Une matière humide et souple est posée sur le visage de chaque modèle de sorte que pendant le temps du séchage toute communication avec le monde extérieur est interrompue : la vue, l’ouïe, l’odorat, mais aussi la respiration et l’usage de la parole sont temporairement arrêtés. Les photographies de ces moulages négatifs reflètent donc les visages de personnes repliées dans une intimité avec elles-mêmes.
Dans ces nouvelles séries et jusqu’à la fin du dernier Cycle, les visages ne ressemblent plus à quiconque et se réduisent à des apparitions délimitées par les jeux de l’ombre et de la lumière. Les images approchent par-là, jusqu’à presque l’atteindre, le peu de réalité de l’image-souvenir et, dans le monde étrange de ces apparitions anonymes, blafardes, obscures ou lumineuses, chacun peut retrouver une part de sa vie intérieure. On voit se dessiner à partir de la genèse de ce travail, notamment avec la destitution de l’idée traditionnelle de portrait qu’il engage, l’aspect ascétique de la démarche de l’artiste qui, par une atténuation progressive des détails particuliers des visages et des corps, parvient à imposer la forme idéale qu’elle veut mettre en scène. La prise photographique devient alors la capture d’une réalité intérieure.
Fixité du regard et vacillement de la figure
Chacun des cycles qui structurent l’œuvre d’Annabel Aoun Blanco est composé de séries parallèles de photographies et de vidéos. Elles ont leur parcours propre mais tendent à se rejoindre. Ainsi dans le Cycle 1, les séries photographiques visent à montrer progressivement une mobilité invisible par accentuation de la fixité du sujet alors que les vidéos intègrent dans leur déroulement une image fixe ou figée qui apparaît dans un laps de temps furtif. Cet agencement est une scénarisation de l’équivalence qu’établit Platon entre l’indivisibilité et la mobilité du Temps. Mais sur un autre plan, celui qui concerne la nature de l’image-souvenir, le dispositif Photo/Vidéo correspond, de façon métaphorique mais efficace, à deux attitudes de l’esprit humain dans son acte de remémoration : sidération, fixation face à une image traumatique dans un cas, perception fugace d’une image en voie de disparition dans l’autre cas.
La vidéo retranscrit les modes de visibilité d’un regard intérieur dans un effort pour cerner le souvenir d’une certaine image. Les vidéos Reviens XI et Reviens XII laissent entrevoir, à travers une ouverture en ove, un visage dans un laps de temps très restreint, puisque la durée totale de passage de ces très courts métrages est de l’ordre de plusieurs millisecondes. Dans cette fraction infime de temps, une agitation intense de la source de lumière et de la lunette d’observation module l’apparition spectrale du visage qui plonge dans l’obscurité totale avant de resurgir subrepticement. Les deux vidéos passent en boucle dans une compulsion de répétition effrénée comme pour simuler l’effort de remémoration autant que la peur de perdre de vue celui qu’on ne voulait pas oublier. Le dispositif met ainsi en scène l’impossibilité d’atteindre un souvenir pur et l’instabilité de la présence de l’objet de mémoire toujours menacé de sombrer dans l’oubli.
Une comparaison de ces deux vidéos avec les photographies couplées Objectif et Objectif II permet de situer les rôles respectifs des deux médiums dans leur rapport avec l’image-souvenir. Dans l’une comme dans l’autre photo, il s’agit d’un visage photographié en médaillon car l’appareil de prise de vue est positionné, à chaque fois, derrière un tube. La distance focale diffère d’une image à l’autre. Dans le premier cas, la figure presque discernable à l’air lointaine et le cercle qui l’entoure est auréolé d’un halo d’obscurité, le tout faisant penser à une éclipse inversée. La longue focale de l’autre image agrandit le médaillon et le sujet semble plus proche, plus éclairé mais pas plus distinct que dans la précédente parce que des reflets le recouvre de petites macules brillantes. La fixation photographique, métaphore du regard intérieur, ne parvient pas à récupérer le souvenir vif et entier visé par la mémoire.
Il ressort de cette comparaison que le recours aux deux médiums aboutit à un résultat similaire : l’impossible saisie du souvenir pur ; mais tandis que la vidéo traduit l’expérience tragique de la remémoration, la photographie construit les métamorphoses de l’objet mnésique.
Les transformations de l’objet mnésique ainsi que son irruption ténébreuse ou lumineuse sont liées au fait que la fixation du souvenir a lieu dans des instants différents. C’est pourquoi la photographie ne restitue jamais aussi bien ces métamorphoses que dans des séquences constituées en diptyques ou en série. Ainsi, dans le diptyque Eloigne moi de toi, la contiguïté de deux images absolument dissemblables – l’une étant toute noire et l’autre contenant un portrait en tondo – correspond en fait à deux prises de vue réalisées sur le même sujet à deux moments différents. Dans un premier temps l’objectif de l’appareil adhère à la matière cendrée, support de l’empreinte du visage, et suivant le même axe, dans un deuxième temps, il se situe en recul par rapport à ce support, marquant sa forme ronde autour de l’empreinte. Rapporté au souvenir, ce couple de photographies montre d’une part, la relation indissociable qui existe entre le regard intérieur et l’image-souvenir et introduit d’autre part la question de la distance convenable à partir de laquelle l’objet de visée peut être perçu. D’où le titre en forme d’injonction du diptyque qui résonne comme une prosopopée de l’image-souvenir : Eloigne moi de toi pour mieux m’apercevoir.
Les séries Ώ (Oméga) et Coups après coups montrent que la distance n’est pas le seul facteur qui brouille les pistes d’accès au souvenir. L’objet cible de la mémoire se caractérise par une instabilité visuelle et un vacillement incontrôlable d’une apparence à une autre. Dans Ώ, le masque, enfoncé à quatre reprises dans l’empreinte qu’il a produit une première fois, se détériore à chaque pression dans la profondeur. Il en va de même dans la série Coups après coups où le masque n’est plus enfoncé, mais frappé plusieurs fois dans le creux initial. Ces gestes de frappe et d’enfoncement successifs renvoient aux efforts mentaux pour approfondir le spectacle du souvenir. Or, cette fixation répétée sur la forme du visage, loin d’en révéler des détails plus précis le métamorphose en des effigies de plus en plus fantômales, comme si l’effort de concentration de l’esprit n’avait aucune prise sur une image dotée d’un devenir propre.
Le devenir de l’image-souvenir tourne en boucle dans toutes les vidéos, ce qu’exprime leur titre qui commencent par Reviens et le retour permanent du film au point de départ symbolise les multiples tentatives de la perception mémorielle pour assurer sans y parvenir la survivance du souvenir. Quand un visage apparaît net, comme au début de la séquence intitulée Reviens c’est pour être immédiatement caché par un jet de poussière qui le rend livide et flou avant que la séquence ne recommence sans autre fin que cette intermittence entre apparition et disparition. Les différents scénarios renvoient tous à cette intermittence comme ce voile qui cache un visage (Reviens XXVI) et qui s’envole un fragment de seconde avant de retomber à nouveau. En fait, les vidéos racontent la quête d’un insaisissable, elles répètent en boucle, de façon compulsionnelle un désir inassouvi de voir ce que, par ailleurs, la photographie s’ingénie à fixer. Elles sont l’illustration la plus pure de la nostalgie, de la douleur du retour qui accompagne le souvenir et confèrent pour cette raison une note de mélancolie à l’œuvre d’Annabel Aoun Blanco.
Matières et mémoire
Dans l’ensemble du dispositif par lequel Annabel Aoun Blanco traduit l’expérience de la mémoire, le choix des matières qu’elle utilise pour ses mises en scène est en relation symbolique étroite avec le sens qu’elle donne à sa démarche. La métaphore qui associe le souvenir à une empreinte dans une matière n’est pas nouvelle : pendant des siècles le bloc de cire a constitué la métaphore privilégiée du support des impressions de la mémoire à cause de l’écriture – outil de mémoire durable – qui s’inscrivait dans la cire. Ainsi, Mnémosyne, déesse de la mémoire, était aussi considérée comme l’inventrice des langages de toute la Terre. Cette matière-là n’apparaît pas dans les travaux d’Annabel Aoun Blanco parce que son modèle n’est pas l’écriture, mais l’image-souvenir dont elle n’entend traiter les différents aspects et avatars qu’avec ses propres images.
Dans la progression des Cycles 1 à 3, les matières sont utilisées selon un ordre chromatique qui va de l’eau au charbon, en passant par la buée, le lait, le plâtre, le sable et la cendre. Cet ordre crée un passage qui va de la lumière vers les ténèbres en harmonie avec l’apparition/disparition des effigies. Chaque matière se caractérise aussi par une fonction qui est, selon sa nature, l’immersion, le recouvrement ou l’impression. A ces fonctions se rattache une symbolique particulière qui relie l’œuvre entière à des archétypes culturels.
L’immersion des corps dans l’eau, dans la série En Suspens, donne l’impression que les sujets photographiés ne sont ni tout à fait vivants, ni tout à fait morts, comme les âmes plongées dans le fleuve Léthé qui, dans la mythologie grecque, conduisait aux Enfers. Le Léthé se situait encore du côté de la vie, contrairement au Styx qui se trouvait déjà du côté de la mort. Cette ambivalence de statut apparent entre la vie et mort n’est pas sans incidence sur la nature de l’image-souvenir que toute l’œuvre d’Annabel Aoun Blanco tend à cerner. L’autre immersion qui a lieu dans du lait, avec la série Danse Contemporaine II et La Sirène, renforce le désir de survivance de l’image-souvenir : les sujets photographiés surnagent dans un liquide qui est le premier aliment des mammifères et qui, de ce fait, est indispensable à la survie.
La série Avatars donne un premier exemple de recouvrement avec une matière à la fois gazeuse et liquide, la buée. Etant donné que les visages sont placés derrière une vitre opacifiée par la vapeur d’eau et que la photographe intervient directement sur cette matière avec son doigt, on peut penser que la vitre est une frontière entre la vie et la mort. D’une part, en effet, les sujets ont des faces de zombis et d’autre part, puisque la buée se situe de l’autre côté on peut imaginer qu’elle est produite par les expirations de l’être vivant qui les regarde. Le souffle, qui ne peut pas rejoindre ces visages hâves, est le symbole du don de la vie. A cet égard, il est remarquable que le geste de souffler intervienne plusieurs fois dans l’œuvre comme un rappel de l’énergie spirituelle qui la parcourt. Cela est particulièrement manifeste avec la série Souffle où chaque image témoigne de l’impact successif de douze jets d’air (provenant de la bouche de l’artiste) soufflés au moyen d’un chalumeau positionné à la hauteur de la bouche de l’empreinte.
Le devenir du souvenir, ses altérations dans la durée et même sa disparition, sont évoqués par le sable quand il est pris en tant que matière de recouvrement. Dans le triptyque du Sablier, un masque en creux est photographié à trois moments de la coulée du sable. Pourtant, dans le dernier instantané de cette progression, le profil du visage apparaît mieux que dans les précédents, ce qui manifeste l’évolution singulière de l’image-souvenir, le déclin de son contour et ses revifs inattendus. Mais l’artiste se sert d’une préparation à base de sable comme d’une surface d’impression dans une image impressionnante intitulée Toupie : sur la surface vierge de toute trace, elle fait tournoyer un objet en forme de visage. Dans un format carré, la figure apparaît encerclée par les traces du tournoiement de l’objet comme s’il reprenait vie dans une quadrature de cercle qui met en scène l’ici-bas et l’au-delà, la divisibilité et l’indivisibilité du temps.
Parmi les matières d’impression, la cendre, poussière inerte et sans vie, résidu d’un corps calciné, est prédisposée à la représentation de la mort. Pour une autre raison qui tient à sa couleur, le charbon aussi puisque le noir est souvent associé au deuil. Pourtant, Annabel Aoun Blanco ne se sert pas de ces matériaux pour illustrer la disparition fatale du souvenir. Dans la série Coups après coups, on a pu remarquer que la cendre était le réceptacle des métamorphoses de l’objet mnésique et non pas seulement l’aboutissement d’un processus d’anéantissement. La photographie intitulée Essoufflé est significative de la valeur insolite que l’artiste accorde à cette matière. Le grain et les scories de la cendre forment la trame de cette photographie où des traits humains apparaissent dans une extrême ténuité, sans que l’on puisse dire si cette esquisse de visage affleure à peine ou s’enlise déjà. La matière devient alors le support d’une représentation quasi immatérielle pour laquelle il faudrait créer le mot de psychophanie.
Sous l’action de la lumière, le charbon prend des tonalités multiples : il peut être chiné d’étincelles dues à certains cristaux de quartz, comme dans le diptyque sans titre, ou devenir presque blanc comme dans cet autre diptyque zoome. Malgré sa couleur ténébreuse, le charbon recèle des pépites de lumière, parfois microscopiques, mais suffisantes pour que des traditions en aient fait un symbole, celui du feu caché. On retrouve cette potentialité dans les clartés que délivrent les photographies qui prennent le charbon comme support, mais de façon beaucoup plus subtile encore dans une vidéo, Reviens XVIIII, où un spot de lumière affaibli révèle, dans l’obscurité complète, des parcelles d’empreintes charbonneuses au gré des méandres de sa course.
L’importance qu’Annabel Aoun Blanco accorde aux matières n’a donc rien à voir avec une métaphore plastique, comme le bloc de cire, qui serait destinée à expliquer les modalités d’impression des souvenirs dans la mémoire. Elles lui permettent de donner corps à l’appel du souvenir, à ce restant d’énergie qu’elle perçoit dans ces images revenantes. Ainsi dans le triptyque intitulé Le Cri, l’insistance des figures à sortir de l’oubli dirige la mise en cadre des figures recouvertes de plâtre. En raison du cadrage resserré qui les contient, le dégradé de l’ombre de fond vers la clarté du centre du visage culmine dans une lumière intense qui définit une limite de crevaison de la surface de recouvrement. Proféré dans le plus profond mutisme, ce cri est une lumière spirituelle.
L’apparition disparaissante
Le paradoxe d’une présence absente ou d’une absence sur le point d’accéder à l’air libre est une hantise qui parcourt le travail d’Annabel Aoun Blanco. Par ces aspects presque surnaturels, l’œuvre se rapproche des visions de l’univers fantastique, des spectres, des fantômes, des revenants et autres créatures oniriques. Mais elle se démarque de ces fictions par une attention scrupuleuse portée à l’expérience réelle de remémoration et par une analyse visuelle des objets indéfinissables de la mémoire. A travers ses photographies et ses vidéos une ontologie du souvenir prend ses assises, une ontologie fragile relative à l’interstice infinitésimal qui conjoint et sépare l’apparition et la disparition, la vie et la mort.
Cette œuvre plasticienne multiplie, avec heurs et déconvenues, les tentatives pour gravir à rebours l’irréversible du temps à la recherche d’un souvenir pur, recherche que Bergson, dans Matière et mémoire, considérait comme une question plus métaphysique que psychologique. De fait, et sans vouloir reprendre une expression bergsonienne, l’œuvre est traversée par une énergie spirituelle qui justifie les références qu’on peut faire, en la contemplant, à d’autres œuvres aux images marquantes comme la catabase d’Orphée, la mort d’Ophélie ou les rives du Léthé.
Annabel Aoun Blanco définit un genre nouveau d’image qu’on pourrait appeler l’apparition disparaissante, si cet adjectif si convenable pour la qualifier, existait. Son exploration visuelle, qui déroule les différentes phases de l’expérience banale du souvenir, a l’envergure d’une grande épopée anonyme où chacun peut reconnaître son univers intérieur. Elle nous conduit tour à tour des ténèbres de la profondeur à la remontée vers la lumière à travers ces visages dévastés, momifiés, effacés ou surgissant, avenants ou intrigants qui pourraient servir d’esquisses préparatoires à un portrait-robot de l’âme.