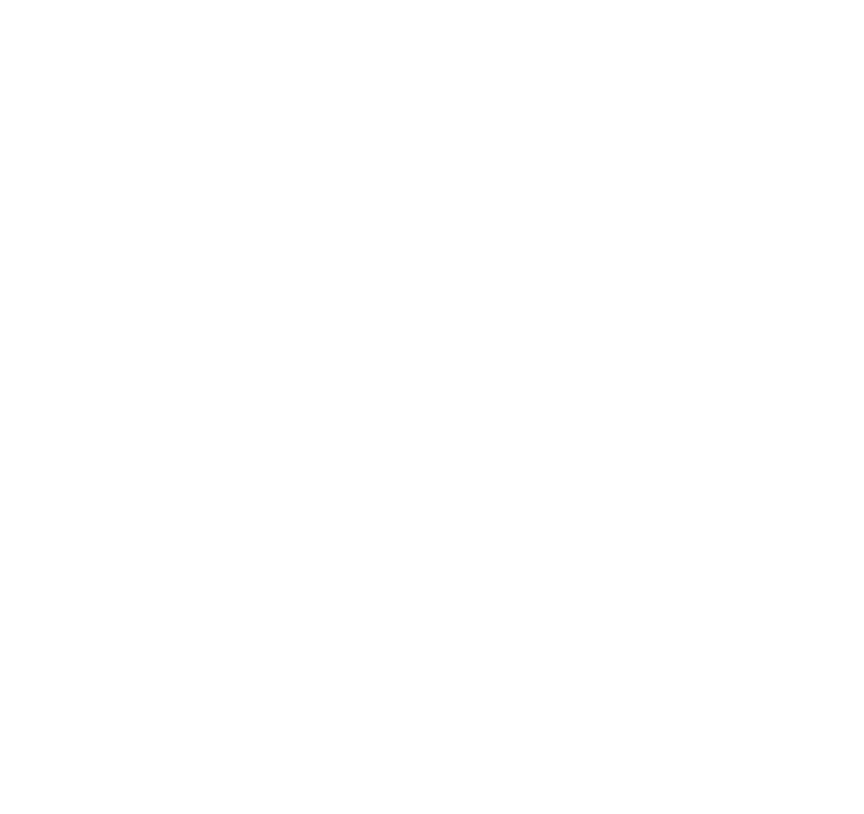LES DIEUX SONT LA…
Bords du Rhône, Arles, 10 avril 2018

Le voir, comme exercice, ne se décide pas. Il est réponse à une attraction qui vient de la nature. Je me laisse ainsi aller, de façon presque quotidienne, à arpenter les bords du Rhône près de chez moi, comme j’aurais aimé le faire, enfant, sur les rives du Bou Regreg, à Rabat. Au sens propre du terme, il s’agit d’une fréquentation. Géographiquement, les lieux que je parcours sont chaque jour les mêmes, mais c’est la visite, l’action de fréquenter régulièrement un endroit déterminé, qui est à chaque fois différente.
En avril dernier, je suis descendu non sans risque au plus près du fleuve. J’ai glissé jusqu’à m’embourber les pieds à hauteur des mollets, et, en me redressant, j’ai vu le profil d’un arbre invisible en son entier quand on suit le chemin piétonnier. Ce fut une illumination, un infime instant de piété Aphrodite avait prêté son corps à la croissance d’un arbre : l’écorce se plissait à la courbure de la croupe, se déchirait à hauteur du sexe, se dressait au niveau des seins. Je me trouvais face à face avec mon propre désir. La visite était devenue un mirage, plus présente qu’une vue de l’esprit, à proprement parler, une Visitation.