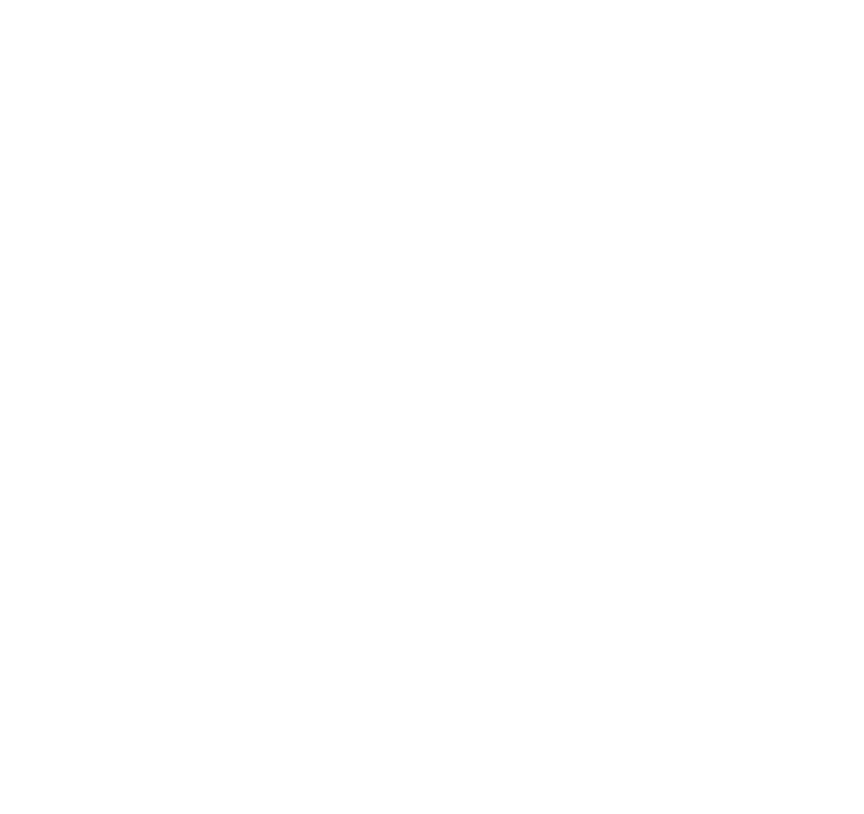Arles – Nuridsany, Guibert, Caujolle : la naissance d’une critique ! Article paru dans l’œil de la Photographie, 1er juillet2019
Pendant 35 ans Robert Pujade dirigera les conférences et les débats lors des festivals. Il s’attache ici à raconter la naissance de la critique photographique française à travers Michel Nuridsany, Hervé Guibert et Christian Caujolle.
Lorsqu’en 1980, le directeur des Rencontres Internationales de
la Photographie me
demanda d’assurer les débats quotidiens entre les photographes
invités et le public du
festival, je ne me doutais pas que cette aventure durerait 35
ans, ni qu’elle déciderait de
mon avenir d’écrivain et de chercheur. Au fil des ans, j’ai préparé
des photographes parmi
les plus célèbres de la planète à supporter cette épreuve d’une
confrontation avec un public
pas toujours commode dont je tentais d’apaiser les réactions
parfois contrastées. C’est dans
ce contexte que j’ai rencontré dès le début de mon activité,
Christian Caujolle et Hervé
Guibert, respectivement critiques à Libération et au Monde. J’étais
fasciné par leur
apparente facilité à écrire au quotidien des textes pertinents à
propos des photographes ;
par opposition à ma lenteur de chercheur universitaire. Je
voulais comprendre comment ils
trouvaient leurs sources d’inspiration et quels étaient leurs
ressources documentaires. Je
dois à Christian Caujolle de m’avoir consacré beaucoup de son
temps pour aborder ces
questions avec moi et permis d’accéder aux archives des
journaux. Il s’en est suivi une thèse
de doctorat de plus de mille pages, La Naissance de la critique photographique en France entre
1970 et 1985.
Les quelques lignes qui suivent n’en sont pas un résumé, mais
une réécriture très succincte
du chapitre consacré à la mise en place des rubriques
photographiques du Figaro, du
Monde et de Libération, un hommage à ces journalistes écrivains
qui ont contribués au
formidable essor de la photographie, dans une période où sa créativité
était méconnue du
grand publicÀ partir de 1971 dans Le Figaro, de 1977
dans Le Monde et de 1978 dans
Libération, une
rubrique critique, concernant l’actualité de la production photographique, va
se mettre en place de façon régulière. Cette rubrique sera tenue
par le même rédacteur,
c’est-à-dire, respectivement pour chacun des quotidiens cités,
par Michel Nuridsany, par
Hervé Guibert et par Christian Caujolle.
Deux observations conduisent à considérer la création de ces
rubriques comme un
événement d’importance dans l’histoire de la photographie :
– Dans la forme qu’elles prennent, tout d’abord, ces rubriques
critiques sont sans précédent
dans la presse quotidienne nationale. Si des articles avaient pu
être consacrés
occasionnellement à des expositions ou à des événements majeurs
de l’actualité
photographique, celle-ci n’avait jamais fait l’objet d’une
information régulière et spécialisée à
l’attention des lecteurs de quotidiens nationaux. La création
photographique devient, à
partir du développement de ces critiques quasi quotidiennes, l’objet
d’une information
suivie.
– D’autre part, la durée même pendant laquelle les critiques
photographiques vont conduire
leur rubrique naissante constitue un phénomène remarquable : ces
premiers rédacteurs
resteront en effet responsables de leur rubrique, au moins jusqu’en
1985,[1] développant
ainsi, à côté de la recherche théorique sur la photographie ou
de la presse spécialisée, un
discours personnel sur la contemporanéité de la photographie et
sur sa valeur esthétique.
Que la photographie apparaisse comme un sujet original dans ces
quotidiens, cela ne
s’entend pas seulement de la nouveauté des rubriques crées à son
intention. Cette
originalité tient aussi au fait qu’entre 1970 et 1980 en France,
la photographie n’est pas
encore reconnue comme un mode d’expression culturel à l’égal de
ceux qui sont suivis et
promus par une critique à la fois active et traditionnelle. Non
seulement les institutions
culturelles, comme les galeries ou les musées, mais encore la
recherche théorique,
historique ou esthétique, manifestent peu d’intérêt pour la
photographie.
Mais plus encore que la rubrique, qui pourrait ne correspondre
qu’à une mise en ordre des
feuillets culturels d’un quotidien, l’intervention d’un rédacteur
spécialisé est le signe que la
photographie est perçue comme un objet culturel distinct, doté d’une
vie propre, appelé à
se développer à l’occasion des événements nécessitant une
attention et une compétence
spécifiques. Ainsi, cette critique journalistique naissante
constitue, dans un contexte
historique où la photographie n’est pas encore pensée, une détermination
particulière de
cette image mal connue.
Ces trois caractéristiques – le sujet, la rubrique régulière et
le rédacteur spécialisé – que
développent Le Figaro, Le Monde, et Libération réalisent bien la naissance d’une forme
particulière de discours sur la photographie. Naissance plutôt
que commencement, car si
l’on a commencé d’écrire sur la photographie, dans les journaux
ou ailleurs, bien avant cette
période, les propos tenus alors ne s’inscrivaient pas dans ce
dispositif.
Mise en place des premières rubriques
Il revient à Michel Nuridsany d’avoir joué un rôle de pionnier
dans la critique journalistique,
rôle d’autant plus difficile que la photographie n’était pas du
tout reconnue auprès du grand
public auquel il s’adressait. Il aborde cette mission dans
contexte plus défavorable que celui
que connurent Hervé Guibert et Christian Caujolle. Il fallait
faire sortir la photographie de
l’oubli où elle était tenue depuis près de quarante ans,
convaincre et instruire sur un sujet a
priori inintéressant
pour les lecteurs des grands quotidiens nationaux. Au cours des années
1977 et 1978, lorsque Hervé Guibert et Christian Caujolle
inaugurent la même entreprise
dans leur quotidien respectif, la photographie est déjà établie
dans des structures qui la
représentent et est devenue, par là même, plus digne de
constituer un élément
d’information périodique.
Quoiqu’il en soit, dans chacun des cas, le développement initial
de ces activités critiques
dans les quotidiens constitue un enjeu d’un double point de vue
:
– d’une part, l’information journalistique sur la photographie
est-elle suffisamment
abondante et attrayante pour développer une chronique régulière
dans un, puis trois
quotidiens nationaux ?
– d’autre part, cette entreprise a-t-elle un sens par rapport
aux lecteurs qui la découvrent et
peut-elle en changer les pratiques culturelles ?
Cette double préoccupation a paru dominante dans la mise en
place de chacune de ces
rubriques critiques dont l’analyse devrait mettre à jour le
statut de critique que s’octroie
chacun des titulaires de ces rubriques, la place de chacun dans
l’emplacement institutionnel
où il écrit et les critères de pertinence qu’il déploie au
recueil de l’information.
Les débuts de Michel Nuridsany (1969-1973).
Les deux premières années pendant lesquelles Michel Nuridsany
prend la plume au Figaro
sont en apparence exclusivement réservées à des informations sur
les nouveautés
technologiques ou à des conseils pratiques et techniques pour
bien réussir ses
photographies dans des circonstances particulières. Durant cette
période la place accordée
à ces articles dans le quotidien est significative : les textes sont
insérés soit dans les pages
intitulées “Tourisme et Loisirs”, soit dans les pages météo.
Presque rien ne distingue alors
ces écrits de ceux que l’on peut lire à la même époque dans le
magazine “Photo”, si ce n’est
un détail qui a symboliquement son importance : Michel Nuridsany
signe ses articles. [2]
A partir de 1971, la rubrique du Figaro prend de l’importance et
l’on voit poindre une
critique photographique autonome se libérant progressivement,
dans le champ de l’écriture,
de l’horizon technique que Michel Nuridsany s’était fixé
jusque-là. De fait, si l’on met de côté
les six articles qui constituent encore cette année-là un propos
uniquement technique, il
reste que l’ensemble des articles développe quatre orientations
nouvelles qui confèrent à la
critique photographique ses conditions de possibilité et d’existence.
Ces quatre orientations
sont les suivantes :
a) une prise de position engagée pour la photographie et une opposition à l’art
contemporain. Par exemple, l’article du Figaro du 5 mai 1971
intitulé Les meilleures
photographies de reporters de Paris-Match, est l’occasion d’établir une différence spécifique
et qualitative entre la photographie et l’art contemporain : Alors que l’art contemporain, dans
son ensemble, tend à se couper de la vie, se sclérose et se perd
en recherches formelles, ces
photographes, humblement, mais avec force, nous montrent dans
toute sa crudité, la vie… c’est
la comédie humaine que ces reporters nous donnent à voir.
b) la recension d’événements importants.
Dix-huit articles sont consacrés à des manifestations en 1971
contre huit seulement à
l’actualité technique. La recension d’événements relativement
importants pour la
photographie, représente une date historique selon le critique
du Figaro : L’année 71
marquera-t-elle une date dans l’histoire de la photographie en
France ? La création de multiples
galeries de photographies à Paris, un engagement de plus en plus
net du public pour ces
manifestations nous inclinent à le penser. La publication de cet
ouvrage[3] qui permet d’espérer
dans l’édition la même évolution, nous confirme dans cette
impression. (Le Figaro, 21/12/1971)
Le début de la critique de Michel Nuridsany coïncide donc avec
les premiers signes d’un
essor culturel nouveau en faveur de la photographie.
c) la découverte de personnalités d’exception dans le milieu des photographes.
La nécessité de promouvoir la photographie à l’égal de l’art amène
Michel Nuridsany à
instituer des génies. Son engouement personnel pour l’oeuvre de
David Hamilton l’amène à
construire un article où le nom du photographe jouxte celui des
plus grands en matière de
littérature et d’histoire de l’art. Déjà l’article s’intitule “À l’ombre des jeunes filles en fleur “ et
commence par une effusion lyrique d’ordre général sur le corps
alangui des jeunes filles qui
font inévitablement penser à Nabokov et à… Hamilton. (Le Figaro,
02/09/1971)
L’autre “phare” de la création photographique est Ernst Haas,
auteur d’un livre, La Création.
La virtuosité du photographe, un des plus grands du moment est assortie des superlatifs
qu’elle suscite (“beauté
stupéfiante”, “lyrisme d’une force inouïe”, etc.) et l’ensemble de cet
éloge à la Création se termine par une phrase composée de deux
comparatifs : “Comme
Michel-Ange, comme Haydn “.
(Le Figaro, 21/12/1971)
Cette entreprise de promotion de génies de la photographie reste
solidaire du combat pour
la défense de la photographie qui est méconnue dans sa dimension
créative et qui, pour
cette raison, justifie qu’une rubrique journalistique la fasse
sortir de l’oubli.
d) la recension d’expositions présentant des intérêts différents.
Les trois premières orientations de cette critique naissante lui
ayant assuré des fondements
possibles, il reste alors à assurer la recension des
manifestations photographiques de façon
régulière. Mais dans cette jeune critique, une caractéristique
singulière apparaît comme une
esquive pour répondre à la difficulté de trouver un langage
adapté à la critique
photographique. L’appréciation positive des oeuvres use d’un
subterfuge qui consiste en
une dérive comparative : la photographie, même mal connue, est l’égale
d’autres arts
reconnus dont on pourra parler plus aisément que d’elle-même.
Ainsi, l’article sur Francisque Hidalgo commence et se termine
par l’affirmation : Francisque
Hidalgo est un photographe impressionniste (Le Figaro, 24/11/1971), David Bailey est comparé
à Antonioni (Le Figaro, 21/06/1971), Lee Friedlander assure la “synthèse entre l’art abstrait et
l’art figuratif”(idem).
Ce parler critique comporte un double enjeu : d’une part, il poursuit la
mission de défense de la photographie en la plaçant, au cours
des recensions diverses, sur
le même plan que les autres arts ou que la littérature. D’autre
part, il faut accréditer aussi
cette critique elle-même qui n’existe nulle part ailleurs, et la
situer pour cela sur le même
plan que celles qui ont droit à des rubriques.
On voit donc à présent comment les quatre orientations prises
par Michel Nuridsany lors de
ce début des activités critiques, s’inscrivent à l’intérieur d’une
stratégie cohérente où sont
liées l’un à l’autre l’essor de la photographie en France et la
naissance d’une critique la
concernant. Le problème du rapport de la photographie à l’art
devient le problème essentiel
de cette critique, puisqu’il en justifie la dimension de combat,
en même temps qu’il confère
à la mission du critique un rôle à proprement parler politique,
puisqu’en incitant le public à
considérer la photographie comme parente des plus grandes
oeuvres de l’art, il peut
espérer modifier des pratiques culturelles, économiques et
sociales.
L’intervention d’Hervé Guibert (1977-1985).
La photographie est présente dans les colonnes du Monde avant 1977, tout d’abord
par des
articles signés Roger Bellone qui ne concernent que la technique
photographique et qui
paraissent à l’occasion, sans constituer une rubrique à fréquence
fixe. Par ailleurs, si Le
Monde publie des articles sur
des événements ou des manifestations importantes
concernant la photographie, cela n’est jamais le fait d’un
critique spécialisé, ni d’une
rubrique particulière dans la page des arts et spectacles[4].
Afin de saisir l’originalité de l’installation de cette critique
dans Le Monde, il est intéressant de
se référer à une biographie rapide d’Hervé Guibert[5] rédigée par Agathe Gaillard
et publiée
par la ville de Nîmes, à l’occasion de la “Rétrospective Hervé Guibert” qui eût lieu dans cette
ville du 8 Juillet au 15 août 1992 : “En 1977, après avoir fait des critiques de cinéma pour
plusieurs revues, il entre au journal “Le Monde”, où on lui confie
la critique photographique. C’est
le début de la grande expansion de la photographie et il fait
partie de cette génération de jeunes
critiques qui découvrent la photographie en même temps que le
public. Ignorant aussi bien de
l’histoire de la photo que de sa pratique, plus facilement
proche des jeunes artistes que des
grands maîtres qui l’intimident, il est semblable au public,
mais un public idéal, sensible,
intelligent, assidu et comme lui, souvent séduit, jamais gagné…”
Ce détail biographique, émanant d’une personne proche d’Hervé
Guibert, tend à établir que
la compétence de départ du critique consiste davantage à avoir
su se fondre dans le regard
du public, à jouer le rôle d’un “public idéal”, plutôt
que d’avoir montré des connaissances
pratiques ou théoriques, et plus particulièrement des
connaissances en histoire de la
photographie. Mais ce qui est surprenant, c’est la rapidité avec
laquelle la rubrique critique
va connaître une importante fréquence : vingt-neuf articles
entre le 22 septembre et le mois
de décembre 1977.
a) La recension critique.
Sitôt qu’il entreprend la rubrique photographique, Hervé Guibert
en propose assez vite une
planification. Dès le mois d’octobre, en effet, en plus des
articles conséquents et développés
sur une exposition particulière, il tâche de mettre en place une
sorte de calendrier des
expositions ou des parutions : des articles plus réduits sont
alors groupés en une colonne
qui prend d’abord le nom de “Notes Photos”, puis
celui de : “Le jour de la photo”.
Sa première prestation relative à la photographie, le 22
septembre, le conduit à écrire sur
une exposition de photographes américains , et sur un livre de
Bill Brandt [6].
Dans le premier article, Hervé Guibert laisse parler le décalage
qui existe entre les images
de l’Amérique qu’avaient “incrusté
dans nos têtes les grandes épopées du cinéma américain “ et
“ l’esthétique du désespoir “ que manifestent les images des douze photographes exposés.
L’angle sous lequel il aborde ces grands photographes (William
Eggleston, Clarence J.
Laughlin, Ralph E. Meatyard, Jerry Uelsman, Eduardo del Valle [7]) est tout à fait
singulier : il
interroge les photographies sur ce qu’elles ne montrent pas (les
hommes, la vie) et c’est son
expérience qu’il invoque contre celle des photographes pour dire
: “Mais ce monde-là est
faux”. La recension de l’exposition
est donc la transcription d’une expérience, celle de la
confrontation entre son imaginaire et les objets photographiés,
et rien n’est dit sur la qualité
des images, leur composition ou leur technique, ni sur les
photographes.
On pourrait interpréter, sans doute, dans cette façon d’interroger
les photographies à partir
de ce qu’elles représentent, comme l’expression d’une certaine
naïveté, le fait d’un homme
qui découvre vraiment la photographie pour la première fois.
Cette façon de voir serait en
accord avec les témoignages selon lesquels il ne connaissait
rien à l’histoire de la
photographie et à sa pratique. Mais cela ne correspondrait pas,
d’une part au sérieux
constant de son travail critique, et d’autre part à la
permanence de cette attitude de
découverte, à cette manière de rapporter l’événement, en mettant
en présence sa propre
sensibilité et celle des photographes, après avoir dégagé le
climat d’une oeuvre [8].
Les premiers écrits sur la photographie donnent la tonalité générale
de ce qui fera
l’originalité de cette critique photographique : la photographie
est d’abord pour lui un prétexte,
c’est-à-dire une prédisposition à l’écriture qui ne trouvera son
plein accomplissement
que si les objets qu’elle montre retentissent sur celui qui la
regarde. Cette relation duelle
que va instituer Hervé Guibert entre les photographes et lui-même
impose les règles du jeu
de la critique, qui se mettent en place dès l’année 1977.
b) Le rapport aux photographes.
On chercherait en vain, dans cette année 1977, des superlatifs
encensant tel ou tel
photographe. La photographie n’est pas abordée par référence à
ses grands hommes [9], ou
par sa structure, mais par ses “effets”[10] à partir des objets qu’elle
crée.
Sur la biographie même des photographes, Hervé Guibert reste
discret, comme si cette
contrainte technique d’information venait perturber son élan d’écriture.
On pourra
remarquer à quel point les éléments biographiques de Bill Brandt
sont instillés à petite dose
dans le cours des descriptions que permettent ses images. En
revanche, le dernier grand
article de cette année, consacré au groupe F/64, est l’occasion
d’un essai biographique
intime sur Immogen Cunningham et de précisions rapides sur Edward
Weston et Ansel
Adams.
On ne voit pas non plus de critiques négatives franches. Rien de
vraiment négatif n’est écrit
sur les photographes américains ou sur leurs images lors du
premier article de1977 : le
propos porte sur le contenu de ce qui est représenté. En fait,
si le jugement de valeur ne
s’impose pas nécessairement, c’est parce que dans l’attitude
critique, la rencontre avec
l’autre prime sur les images qui en sont le prétexte. Dans l’article
sur Jan Saudek, Hervé
Guibert invoque la psychanalyse pour une lecture des photos qui
permettrait, sans doute,
d’aller plus loin que là où il est lui-même porté par le
spectacle : “Il élabore lui-même ses
images, un peu comme on compose un fantasme… Ses photos sont
avant tout des idées de
photos. Il met en scène ces idées qui semblent s’imposer à lui
avec l’évidence du rêve, de
l’obsession.” Si la
photographie permet de remonter ainsi jusqu’à la mentalité de celui qui la
crée, la critique devient alors une confrontation de personnalités.
Cette idée sur l’origine mentale ou fantasmatique des
photographies fera son chemin chez
Hervé Guibert, puisque dans son essai L’image Fantôme [11], il écrira trois textes qu’il intitulera
“Fantasme de photographie“. Ces textes effectuent le chemin inverse que celui emprunté
dans l’article réservé à Jan Saudek; ils vont du fantasme exprimé
à l’image possible et
développent des idées de photographies qui se soutiennent déjà
par elles-mêmes,
puisqu’elles peuvent trouver corps dans l’écriture.
Ce va et vient, entre la pensée qui s’écrit et l’image qui se
fait, situe les conditions de
possibilités d’un lieu commun entre le texte et l’image et d’une
rencontre entre le critique et
le photographe.
c) Les effets de la photographie.
Mais de cette rencontre, précisément, va naître soit un terrain
d’entente ou d’harmonie qui
permettra à la plume du critique de s’inspirer des objets
conservés par le photographe,
soit un rapport de force dans lequel le critique sera trop (ou
trop peu) affecté par les
images.
Les photographies de Diane Arbus donnent lieu à un commentaire
rapide parce qu’elles font
mal. Elles font trop d’effets, on ne s’y reconnaît plus entre le
normal et l’anormal, mots qu’on met
généralement entre guillemets, par décence. (Le Monde, 11/09/1977). Les photographies de
Berlin Ouest par Gabriele et Helmut Nothelfer font naître au
contraire un long commentaire
à cause de leur apparente austérité qui cache autre chose : L’air de rien, elles font peur.
L’insignifiance ne tarde pas à devenir menaçante (20/10/1977)
Ces effets par trop impressionnants montrent que le critique débutant
attend quelque
chose de la photographie qui ne trouve sa formulation que dans
les termes de simplicité (à
propos d’André Martin ou de Bill Brandt), de norme (à propos de Guy Le
Querrec), ou de
banalité (à propos
de Denis Gheerbrant). Ces termes qualifient non seulement des “effets”
de la photographie, mais ils désignent aussi des indices de résonance
entre les
photographies et l’écriture critique, et ils situent les
relations harmonieuses qui peuvent
naître au sein du couple de personnalités en présence dans le
vis-à-vis critique.
L’approche de la photographie par les effets qu’elle dégage,
engendre, dans sa version
positive, la solution médiane et l’atmosphère de bonne entente
qui permettent au critique
de se retrouver lui-même dans les images qu’il promeut. À l’horizon
des photographies qui
se situent ainsi dans le milieu où les effets de l’image
rejoignent les attentes du spectateur,
un texte est à naître parce que deux imaginaires communiquent.
La critique devient alors
l’espace d’un échange entre l’image et le texte.
d) Le parti pris de la vie contre l’art
Hervé Guibert situe le principe d’un accord possible entre la
vision photographique et
l’écriture qui en rend compte dans ce qu’il appelle la vie. Cette notion de vie est
explicitement évoquée à de nombreuses reprises dans les textes
de 1977 et elle constitue
l’un des termes les plus récurrents dans l’ensemble de ses
critiques, au point même de
constituer une critère d’appréciation des photographies.
Deux critiques publiées le même jour [IV] sont organisées autour de
cette notion.
Dans “L’esthétique du sordide”, consacré à Jan Saudek, c’est à partir de la vie que l’article
est
introduit : “Yan
Saudek,(sic) n’est pas quelqu’un qui se promène à travers la vie en attendant
d’être sidéré par une image…”, et conclut : Il
ne parle de la vie qu’indirectement, par
représentations et par symboles (Le Monde, 13/10/1977)
Dans “La banalité surprise“, consacrée à Guy Le Querrec, il est dit que “ son travail n’est
jamais dissocié de la vie…”, puis après une première description de reportages : “Le Querrec
donne une vision plutôt bonhomme de la vie”. Par la suite, après avoir évoqué les images de la
quotidienneté “assez terrifiante” des Français en vacances, Hervé
Guibert écrit : On n’a pas
envie de rire, on se reconnaît, on se dit : la vie c’est bien ça,
et après, on serait malhonnête de se
dire que c’est l’horreur…
(Le Monde, 13/10/1977)
Cette remarque de conclusion est importante, car elle éclaire
quelque peu cette notion de
vie qui apparaît comme un concept opératoire dans tout le
travail critique, mais sans jamais
être théoriquement définie. (Il faut reconnaître que la définition
théorique de cette notion
est infiniment problématique.)
Dès le début de son intervention au Monde, Hervé Guibert institue
une forme littéraire de
critique photographique en préservant, dans l’écriture critique
sa personnalité d’écrivain-spectateur
qu’il confronte au regard des photographes. L’ensemble des
textes de ce départ
de 1977 supporte déjà le propos rétrospectif qu’Agathe Gaillard
portait sur l’ensemble de
son oeuvre critique : Il
ne se place ni en juge, ni en professeur, mais donne une réponse, injuste
quelquefois, mais réelle. Il ne milite pas, reste réservé et indépendant,
mais il voit.
L’arrivée de Christian Caujolle.
En novembre 1978, quand Christian Caujolle commença son travail
de critique, la
photographie ne connaissait pas de rubrique régulière à Libération. La
relation
d’événements importants était assurée par des journalistes
affectés à d’autres spécialités,
comme Bernard Dufour qui écrivait sur la peinture. Il aura fallu
un changement de politique
éditoriale du journal, en 1978, avec une franche orientation du
côté de l’information
photographique, pour qu’une spécialité journalistique apparaisse
nécessaire en ce domaine
et que se découvre une place vacante.
Dès le début de l’année 1979, Christian Caujolle va donner à sa
rubrique critique son aspect
original et régulier. En plus des articles consacrés
exclusivement à une manifestation, un
feuillet hebdomadaire intitulé “Photo-hebdo” qui
constitue un véritable guide des
expositions photographiques. L’originalité de cette page
hebdomadaire n’est pas seulement
de signaler les expositions visibles à Paris, mais de tenir les
lecteurs au courant de ce qui se
passe en province. Chaque semaine est introduite par une note d’ambiance
sur l’état
présent de la création photographique et se conclue souvent par
une note d’humeur. Par
ailleurs, toutes les expositions proposées sont assorties d’un
commentaire succinct sur
l’essentiel de leur contenu, ce qui fournit l’occasion à
Christian Caujolle de produire des
variations d’écriture sur les manifestations qui se maintiennent
plusieurs semaines durant.
En ce qui concerne les articles de fond, centrés sur un événement,
ils portent aussi bien sur
des photographes confirmés (William Klein, Édouard Boubat, Bruce
Davidson, etc.), que sur
des rétrospectives d’anthologie (Eugène Atget, les Seeberger ou
les Reutlinger) ou sur des
événements de moindre importance.
La rubrique s’organise donc autour d’un double rythme d’écriture
et de compte-rendu qui
lui confère une dimension authentiquement journalistique : le
guide hebdomadaire,
abondamment fourni, prête à la photographie une place aussi
importante que celle allouée
dans le journal aux autres manifestations des arts et des
spectacles. Il fait le point sur les
doutes et les espoirs que la photographie connaît au quotidien.
Les articles isolés qui
approfondissent les annonces rapidement commentées du guide
tendent à instaurer
auprès du public une connaissance du monde des photographes.
Pour y parvenir, Christian
Caujolle va au-delà de la recension simple des manifestations
photographiques. Il a recours
à la technique d’entretien, à la présentation d’auteur, à la
biographie, au récit personnalisé
qui permet une introduction plus intime dans le milieu des
photographes, ou à la rêverie
poétique avec les photographies.
En fait, ce double mouvement dans l’écriture critique correspond
à la fois au souci
d’information propre au journalisme, mais aussi à l’idée que le
critique se fait d’une histoire
de la photographie qui reste à écrire et qu’il exprimera un peu
plus tard : Deux histoires de la
photographie sont possibles. Celle qui se veut globalisante et
celle qui aimerait friser les doutes
quotidiens de la photographie (Libération, 22/06/1983). Le dispositif mis en place au cours de
l’année 1979 est cohérent avec ces deux histoires possibles, et
il dégage trois
caractéristiques que l’on retrouvera tout au long du travail
critique.
a) Une critique élargie.
Le premier aspect de cette critique naissante, c’est qu’elle vise à rendre compte du plus grand nombre de manifestations possible. C’est la mission que remplit “Photo-hebdo” : rendre compte le plus largement possible des événements de Paris et de province. Christian Caujolle n’hésite pas à souligner, en introduction à certaines de ses rubriques la performance que représente sa détermination à faire le tour des expositions. Ainsi, le 2 mai, il écrit sous le titre Des expos, toujours des expos : Faire la tournée des galeries qui exposent actuellement de la photographie se révèle un exercice de plus épuisant (sic). Il y en a partout et dans certaines galeries, le rythme est tellement rapide qu’on n’a presque pas le temps de regarder que tout est déjà décroché et remplacé par la nouvelle « expo du mois ». Ça amène forcément à voir autant de travail de photoclub que d’expositions construites et justifiées.
Cette remarque apparemment anodine, qui ressemble à tant d’autres écrites lors des “Photo-hebdo” de cette année 1979 [12], montre de quelle manière il effectue son travail : visiter tout ce qui se présente et rendre compte des choses qu’il faut voir.
Le travail critique consiste donc d’abord en une sélection de l’information qui s’effectue par élimination des productions d’amateurs, représentées à cette période par les activités de photo-clubs qui apparaissent tout au long des critiques comme le comble du mauvais goût.
Mais cette sélection n’a pas pour effet de promouvoir simplement le bon goût reconnu par l’actualité officielle de la photographie. La critique doit aussi faire connaître des initiatives inaperçues qui apportent une contribution méritoire à la création et à la recherche photographiques. C’est le cas de la présentation des éditions “Phot’oeil” qui donne l’occasion du premier article de l’année, ou du livre L’ami Pierre[13], réalisé par Jean-Philippe Jourdrin : c’est par leur annonce commentée dans le journal que ces deux initiatives parviennent à la connaissance du public. De la même façon, le “Photo-hebdo” du 17 Avril signalera la publication d’un livre algérien El Djazaïr qui trouve sa place dans la rubrique, compte tenu des difficultés de l’édition algérienne. Enfin, dans le contexte de cette critique élargie, la rubrique Photo-hebdo révèle des talents qui se confirmeront plus tard : Bernard Faucon[14] et Jean-Claude Larrieu, par exemple.
Cette première caractéristique de la critique de Christian Caujolle semble montrer son attachement à une photographie vivante, en recherche, et libérée d’une quête de la grande photographie ou des génies qui la constitueraient. Christian Caujolle apporte à cette critique, par ses moyens d’investigations, la dimension du journalisme professionnel qui lui manquait.
b) Une critique journalistique.
La deuxième caractéristique de cette critique, c’est sa parfaite intégration au journal Libération. Les variations de tons empruntées par Christian Caujolle donnent à sa chronique le côté vivant d’un feuilleton. On pourrait citer à cet égard, les comptes rendus des Rencontres d’Arles qui d’année en année, sont présentés comme un feuilleton à épisodes, où le critique est tour à tour violent, moqueur, admiratif et toujours très personnellement impliqué dans la restitution qu’il fait de l’événement. Pour l’année 1979, une présentation du programme est proposée sous la forme d’un récit de fiction où un visiteur des Rencontres serait accueilli par les grands photographes et profiterait de ces Rencontres dans des conditions idéales.
La rubrique épouse peu à peu la tonalité générale du journal connu pour ses titres en forme de calembours et pour son langage libéré. Pour les titres des articles, l’année 1979 donne l’impression que le jeune critique, tout rempli du sérieux de sa nouvelle charge, se contient quelque peu. En ce qui concerne le langage utilisé, Christian Caujolle manie, au gré des circonstances, différents niveaux de langue. La plupart des articles sont écrits en langage courant, sans préciosité, ni recherche de formule. Mais il emploie à l’occasion un langage populaire ; cela peut être par effet de mimétisme avec le sujet traité : “Des p’tits mecs à Berlin”, par exemple, ou bien dans l’article consacré au photographe William Klein qui, ayant été explicitement défini comme photographe de la rue, autorise alors le langage de la rue : “Il fait ce qu’il aime, il emmerde tout le monde… et, dans tout le petit monde de la photo, ça hurle que c’est vraiment de la merde…(23/02/1979) À d’autres endroits, ce langage populaire est destiné à manifester sa mauvaise humeur. C’est la galerie de l’espace Canon qui subit les affres des colères les plus vertement exprimées : On n’en parlera plus parce que c’est à dégueuler : “Au-delà”, à la galerie Canon /…/Cette vitrine marchande /…/ se fout une fois de plus de notre gueule… (22/05/1979)
Mais on peut remarquer que ce langage de la mauvaise humeur, qui n’explique ni ne décrit rien, est cependant l’indicateur d’un seuil critique : celui où, justement, l’écriture critique se trouve placée en face d’un inqualifiable. Le niveau de langue utilisé n’est donc pas seulement un subterfuge destiné à rendre la rubrique plus lisible ou plus vivante, mais la marque, dans certains cas, de la frontière entre ce qui relève de la critique et ce qui n’en constitue pas l’objet : “ …une saison épuisante s’annonce, proche de l’inflation photographique avec son lot habituel de bonnes surprises et de dégueulis (10/09/1979)
Cette démarcation qui sépare le photographique en tant que tel de la simple illustration, s’inscrit déjà dans l’aspect didactique de cette rubrique.
c) Une rubrique didactique.
L’arrivée de Christian Caujolle est concomitante à une véritable explosion des manifestations photographiques, particulièrement dans la région parisienne qui connaîtra dès l’année suivante, en 1980, son Mois de la Photographie.
Son activité initiale est donc liée à l’urgente nécessité de faire le tri, en une période où la photographie se découvre comme un phénomène total, c’est-à-dire non seulement esthétique, mais historique, technique, scientifique et économique. Il devient donc urgent d’instruire le public sur les seules manifestations construites représentant le travail des photographes dans des conditions dignes du sérieux de leur entreprise. D’où l’importance que revêt, dès 1979, la chasse à l’amateurisme : elle ne porte pas seulement sur une esthétique du goût contre les photo clubs, mais sur toutes les conditions d’exposition et de présentation des photographies.
C’est ce qui rend exemplaire la critique polémique des
Rencontres d’Arles, dès cette année :
Christian Caujolle explique très clairement qu’une manifestation qui veut représenter la photographie de façon internationale ne peut pas se permettre de bricoler pour la présentation d’images d’auteurs. “Ce qui était hier un sympathique amateurisme, devient aujourd’hui un insupportable manque de sérieux… Il faudrait penser le spectacle comme une mise en représentation sévère d’images incontestables”[15].
Il ne s’agit plus, comme pour Michel Nuridsany, de faire connaître l’existence de la photographie comme un art à part entière[16] , ou même de faire découvrir la photographie,comme le faisait Hervé Guibert dont la plume retranscrivait le regard d’un “public idéal”,pour reprendre l’expression d’Agathe Gaillard. Il s’agit d’installer une connaissance de la photographie, de ses oeuvres et de ses auteurs.
Telle sera la tâche de cette nouvelle critique essentiellement axée sur l’information, et moins fournie que d’autres en jugements de valeur. Elle sera, en effet, moins formulée en termes de bonnes ou de mauvaises photographies, – ce qui risquerait de renvoyer à nouveau aux questions de l’amateurisme ou à la dénaturation de la photographie par les marchands américains[17], mais en termes d’analyse et de fréquentation du monde des photographes.
Et pour parfaire cette connaissance de la photographie comme phénomène total, la critique aura pour fonction non seulement d’apporter une contribution à l’histoire des photographes, mais encore de détecter dans l’essor de la technique photographique, les éléments pouvant permettre une meilleure compréhension des enjeux qu’elle constitue dans le système économique et social.
Cette attitude didactique, qui relève aussi d’une défense de la
photographie, ne tient pas
seulement à la culture personnalisée du critique. Elle semble s’imposer en raison du développement considérable des manifestations photographiques à partir de 1979.
Avec l’arrivée de Christian Caujolle, la photographie est parvenue à son âge adulte : c’est cette prise de conscience que révèle sa première année de critique à Libération, et c’est le respect de cette majorité que le critique s’évertuera à protéger.
[1] C’est à la fin de l’année 1985 qu’Hervé Guibert et Christian Caujolle arrêteront leur activité critique dans leur quotidien respectif. Il n’en ira pas tout à fait de même pour Michel Nuridsany qui commence à se désintéresser de la critique photographique à partir de 1980.
[2] Signe du peu de prestige que revêt la fonction d’écrire sur la photographie, les articles techniques de “Photo” ne sont jamais signés jusque dans les années 80 : il en va quasiment de même pour les présentations de portfolios dans le même magazine. Pendant la même période, la revue “ZOOM”, plus largement consacrée à l’image, fait quelquefois précéder la revue d’un portfolio d’un texte court de présentation agrémenté d’une signature prestigieuse.
[3] Il s’agit de La
Création de Ernst Haas, Le Chêne,
1971.
[4] Pour une analyse exhaustive des textes concernant la photographie dans Le Monde précédant les premiers textes d’Hervé Guibert, Cf. Robert PUJADE, Naissance de la Critique photographique, ch. I, 2, B.
[5] Rétrospective réalisée avec le concours des Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles.
[6] Le Monde, du 22-09-1977 : Ombres et Lumière,
éd. du Chêne, 1977.
[7] Les seuls noms qu’il cite sur les douze photographes exposés.
[8] Dans un de ses derniers articles du Monde, Hervé Guibert thématisera la notion d’”atmosphère” comme une puissance vocative interne à l’image et dirigée vers l’imaginaire du spectateur. (M. du 14-11-1985)
[9] Quand Brassaï est cité, par exemple, à propos de Bill Brandt (M. du 22-09-1977), ce n’est pas pour avancer un modèle de photographe, mais pour évoquer une atmosphère, et le nom du grand photographe fait alors partie du matériel descriptif du texte d’Hervé Guibert.
[10] Le terme d’”effet” est parfois employé par Hervé Guibert dans le sens fort d’une emprise du spectateur par le pouvoir de l’image. (cf. à propos de Diane Arbus, Le Monde du 9-11-1977).
[11] L’Image Fantôme, Minuit, 1981, pp.31, 87 et 127.
[12] Sur le même constat d’une inflation des expositions de photographie cette année-là, cf. L. des 8-05, 19-06, 10-09, 18-09, 02-10, 09-10, 06-11 et 27-11- 1979. Dans ce dernier article daté du 4 décembre, on peut lire : “Y aurait-il une mode de la photographie ?… L’amateurisme et les approximations grossières qui entourent certaines de ces promotions tapageuses pourraient bien faire fuir ceux qui commencent réellement à s’intéresser à la chose.”
[13] L. du 3-04-1979. Jean-Philippe JOURDRIN, L’ami Pierre, Paris,
Duculot, 1979.
[14] L. des 17-04, 3-05, 8-05 et 22-05-1979. Sur les conséquences de cette critique élargie et révélatrice qui ne se limite pas à la simple production d’un article, le témoignage de Christian Caujolle est éclairant: “J’ai pu aussi faire partager mes coups de coeur. Pour Bernard Faucon et Jean-Claude Larrieu, entre autres… que Agathe a accueillis et montrés alors que personne ne s’intéressait vraiment à eux.” in Souvenir d’Agathland, op. cit., p 10.
[15] Cet article résume à lui seul la plupart des polémiques qui surviendront au cours des années suivantes à propos des Rencontres : il porte sur “les dimensions de l’amateurisme”. L. du 25-07-1979.
[16] On peut même dire que cette question apparaît dans la critique de Christian Caujolle comme un “obstacle épistémologique“, au sens où l’entendait le philosophe Bachelard, à la connaissance de la photographie. cf. par exemple L. des 27-11 et 11-12-1979.
[17] Contre les confusions sur les valeurs (économiques et esthétiques) de la photographie,cf. L. du 25-07-1979 où Arles apparaît menacée par l’intrusion des marchands, et L. du 9-10-1979 où Christian Caujolle se déchaîne contre la galerie Zabriskie qui vend des “vintagesprints”.