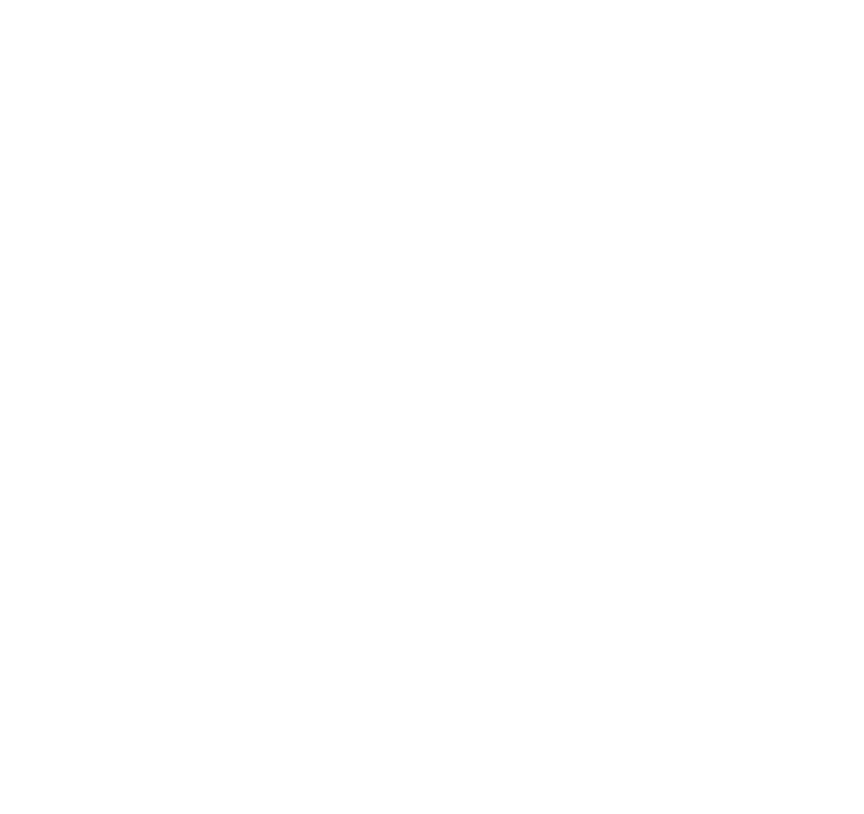Annabel Aoun Blanco– Le souvenir d’une certaine image… 2018

Réflexions sur l’œuvre d’Annabel Aoun Blanco
L’œuvre d’Annabel Aoun Blanco s’inscrit malaisément dans le genre du portrait auquel, de prime abord, on est pourtant tenté de la rapporter en contemplant ses tableaux photographiques ou ses vidéos. Apparaissent des formes de visages, aussi imprécis que des empreintes ou livides ainsi que des moulages, impressionnants dans leur expression et attirants par l’énigme qu’ils recèlent, comme s’ils illustraient de façon littérale la célèbre pensée de Pascal : Un portrait porte absence et présence, plaisir et déplaisir.[1] Par là même, les modèles qui ont servi à réaliser ces portraits semblent plus imaginaires que réels, ce sont des masques rappelant tour à tour des spectres, des momies, des fantômes en fonction du traitement subi avant les prises de vue ou parfois de vrais visages affranchis de leur personnalité, comme dans la série Avatars .
La raison d’être de tels portraits n’est pas l’affiche d’une identité, mais bien plutôt la mise en évidence du mode d’apparition des figures qu’ils révèlent, le portrait n’ayant plus d’autre fin que celle de réfléchir la portraiture dans sa complexité et dans son rapport avec la mémoire. Ce qui intéresse tout particulièrement Annabel Aoun Blanco c’est la souvenance, la façon dont l’image des portraits, fixe ou animée, rappelle cette représentation inconstante et fragile visée dans l’acte de se souvenir. Voilà pourquoi les modèles vivants n’apparaissent qu’au tout début de son œuvre, s’éclipsant pour laisser la place à des empreintes directes, à des masques, à des sujets qui sont déjà des images.
Tout le dispositif plastique mis en œuvre par l’artiste est orienté vers une phénoménologie du souvenir, la photographie ou la vidéo rapportant, selon un régime de visibilité variable, les impressions fugitives saisies lors des actes de remémoration. On peut remarquer au moins deux modalités d’apparition et de disparition de ces images fugaces.
Tout d’abord, l’émergence ou l’enfouissement. Dans la série intitulée Danse contemporaine II, des personnages sont immergés dans une mare de lait et ne laissent apparaître, sur la surface de flottaison, que leurs membres ou une partie de leur visage. Dans d’autres séries plus récentes, les masques sont camouflés par trop ou trop peu de lumière (séries photos : Caresses, Eloigne-toi de moi et Décadrés, par exemple) ou oblitérés par diverses matières : cendre, sable, poudre de charbon, voilage. Dans chaque cas, l’accès à l’image se profile dans l’instant infinitésimal où la présence du sujet est sur le point de surgir ou d’être engloutie dans la monochromie l’oubli. Ces apparitions subreptices ne sont pas sans rapport avec la représentation mythique de la mort d’Ophélie qui a hanté l’histoire de la peinture : personnage secondaire de la pièce d’Hamlet, sa disparition relatée par la reine (Acte IV, sc.7) marque, dans sa description, ce moment fatal où la princesse va cesser d’être visible. La fascination pour la limite entre la vie et la mort, l’apparition et la disparition, et la présence qui cède la place au souvenir a fourni une source abondante d’inspiration pour les peintres, ce qui fit dire à Rimbaud :
Voici plus de mille ans que la triste Ophélie
Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir[2]
Toute l’attention créative d’Annabel Aoun Blanco se concentre sur ce passage métaphorique du blanc au noir, comme l’indique l’image centrale intitulée : ∞ (infini).
L’autre modalité récurrente d’apparition et de disparition de l’image-souvenir consiste en un arrêt sur image, une fixation sur un faciès presque discernable qui porte cependant les marques de sa désagrégation. L’effet produit par cette vision diffère sensiblement selon le médium utilisé.
Dans certaines photographies, la fixation focalise l’apparition d’un visage porteur des marques du temps. La séquence intitulée Zoome propose l’enfouissement d’une même empreinte de visage, à deux moments différents, dans de la poudre de charbon : de l’une à l’autre, on note une progression de la dévastation des traits et la séquence Dezoome III grossit à la loupe la surface corrodée d’une moitié de la face. L’image intitulée Dezoome isole le cercle de la loupe centrée au milieu d’un visage ravagé, plongé dans l’obscurité pour signifier son acheminement vers la mort. L’élaboration plastique de cette fixation sur des apparences en voie de disparition interprète, à la manière d’une fascination, la notion de mnème qu’utilisait la psychologie pour désigner la trace organique qui serait la base matérielle du souvenir.
Avec les vidéos, cette fixation dure le temps d’une infime éclipse où la disparition intervient presque aussitôt après l’apparition dans le mouvement perpétuel d’une boucle cinématographique. Dans la vidéo intitulée Sneiver qui dure dix seconde, une seconde à peine est réservée à l’apparition du visage. Dans celle intitulée Reviens, l’ombre grise du visage s’éclaircit une fraction de seconde avant que ses traits ne soient occultés par un vent de cendre. Dans d’autres encore, notamment Reviens II et III, u n événement identique se produit sous l’action d’éclairages intermittents.
Les boucles vidéo répètent, de façon compulsionnelle, un désir sans cesse inassouvi de voir ce que, par ailleurs, l’objectif photographique parvient à fixer ; mais ce qui est ainsi fixé se présente à la vue sous les aspects du ravage et de la décomposition. L’image-souvenir dépérit dans l’irréversible du temps, comme dépérit l’image d’Eurydice sous le regard malheureux d’Orphée se retournant trop tôt en arrière, aux sortir des Enfers, pour s’assurer de la présence de son épouse. C’était trop tôt, mais subitement trop tard dans le cours unidimensionnel du temps. La belle dryade s’est transformée en un souvenir voué lui-même à la disparition, mais reviviscent dans la lyre d’Orphée qui inspire les artistes et les poètes depuis l’Antiquité.
Que des références mythiques s’imposent tout uniment dans la considération des réalisations d’Annabel Aoun Blanco montrent suffisamment la puissance émotive qui parcourt l’ensemble de l’œuvre. Tout d’abord, par son implication personnelle dans les titres qu’elle choisit pour chacune de ses images et qui résonnent comme des ordres qu’elle lancerait à un disparu (Reviens I-XXVI, Eloigne moi de toi, Détends-toi) ou des ordres adressés peut-être à elle-même (Zoome, Dézoome…). Par la compréhension, ensuite, du lien qui unit les sujets de sa pratique artistique avec la nature des médiums qu’elle utilise : la redéfinition esthétique de l’empreinte et de la trace, le grain photographique qui s’associe parfaitement aux aspérités de l’image-souvenir et les séquences vidéo qui s’essayent obstinément à l’escalade à rebours du temps. Enfin, par la douce mélancolie dégagée au fil des images par cet appel au revenir du temps qui semble développer le final de Du Côté de chez Swann : Le souvenir d’une certaine image n’est que le regret d’un certain instant.
Ces quelques réflexions n’ouvrent que partiellement le champ de l’œuvre admirable et ambitieuse d’une jeune artiste.
1er
jour du printemps 2018.
[1] Pascal, Pensée 678, Ed Brunschvicg.
[2] Arthur Rimbaud, La Mort d’Ophélie.