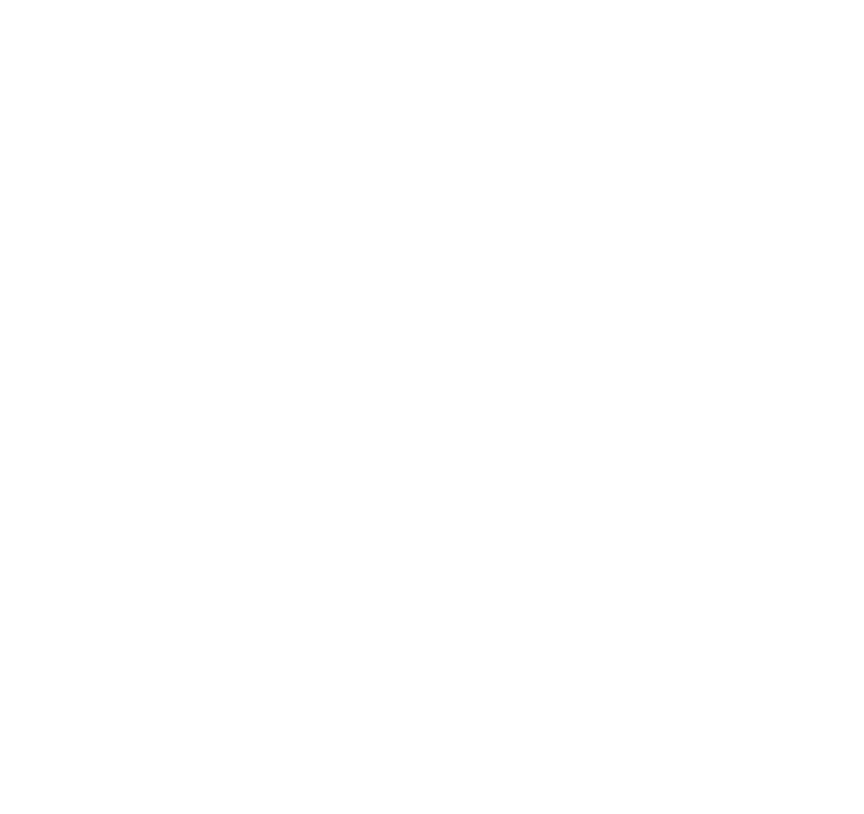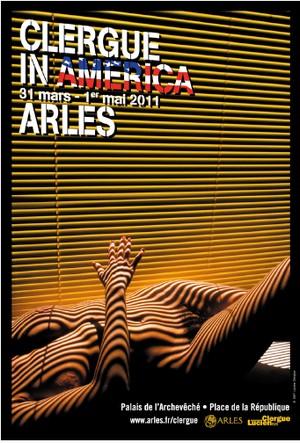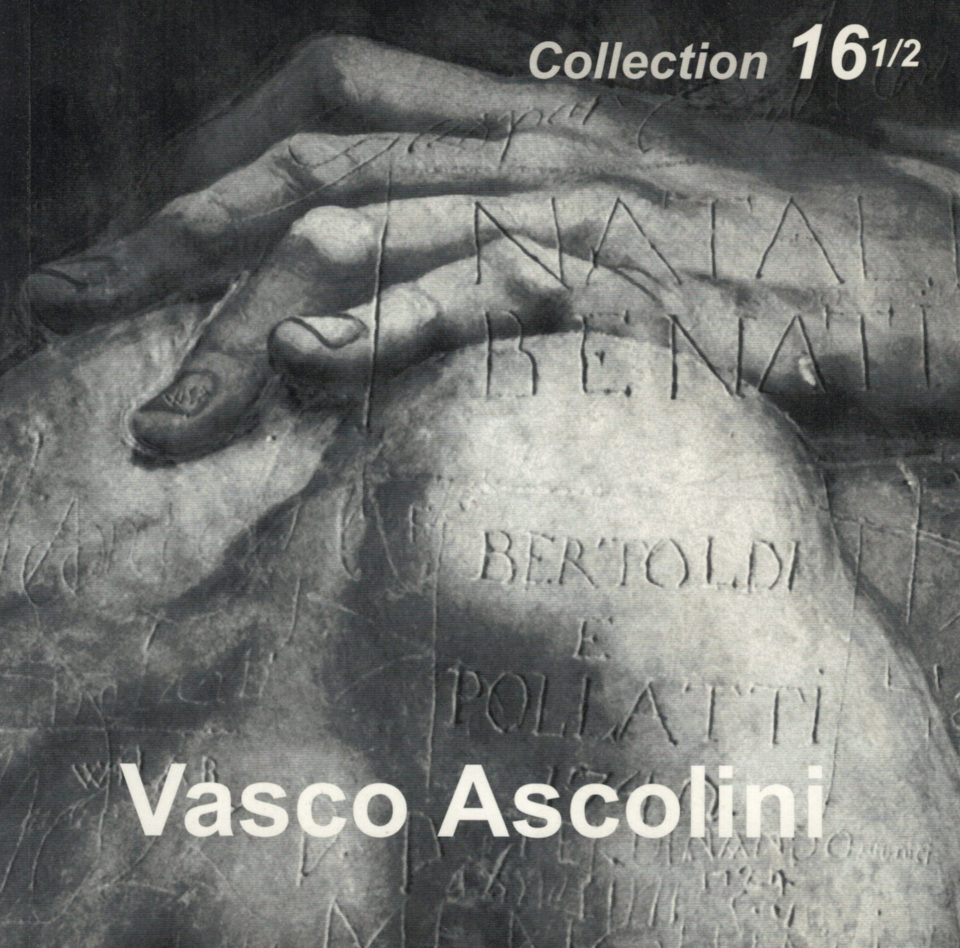Arno Rafael Minkkinen construit depuis le début des années 70 une œuvre de photographie qui relève de l’autoportrait puisqu’en chaque image, il est l’opérateur et le sujet de sa prise de vue, mais la référence à ce genre photographique ne se réduit pas à cette seule définition minimale. L’œuvre entière est vouée à l’exploration d’un espace hors normes où les codes usuels de la représentation sont remis en question et cela est d’autant plus étrange que cet espace, c’est la photographie elle-même. La photographie dont on attend, à cause de sa perfection technique, qu’elle restitue fidèlement toutes les apparences du monde, devient ici l’instrument d’un doute à l’égard de la réalité. Ainsi, la notion du paysage, qui tient une place si importante dans les photographies de Minkkinen, est dévoyée quand la vue d’ensemble d’un site est hantée par une présence qui lui est à la fois tout à fait étrangère et tout à fait intime, totalement déplacée et totalement intégrée dans le décor paysager.
Si, pour commencer la visite de cette œuvre, l’on se réfère à son image la plus célèbre, Narragansett, Rhode Island, 1973 (p. 32), le spectateur est tout d’abord désappointé devant une forme qu’il ne reconnaît pas, mais dont il pressent, par la force du cadrage, qu’elle est à la bonne place au plein cœur du paysage : ce qui surgit là, dans un site séculairement propice à l’échouage de toutes choses venues du large, ressemble à un appariement entre l’homme et les chéloniens. Le regard est happé au cœur même de l’image, dans le creux noir d’une bouche qui devient le centre aveugle autour duquel un ordre insoupçonné déstabilise la vision banale d’un bord de mer.
Le photographe met son corps en scène pour qu’il fusionne avec le décor naturel de sorte qu’on ne l’aperçoit d’abord que comme une anomalie du paysage et il faut le temps d’une hésitation avant de reconstruire les deux ordres incompatibles réunis par la photographie pour produire une pure image. Cette hésitation est plus ou moins longue, comme dans la photo intitulée Pachaug, Connecticut, 1974 (p. 34) difficile à déchiffrer : on ne saisit pas au premier regard le visage émergeant de la ligne de flottaison qui s’est anamorphosé dans son propre reflet, créant ainsi une figure improbable. Et dans d’autres images, comme Oulunjärvi Afternoon, Paltaniemi, Kajaani, Finland, 2009 (p. 30), ce temps de latence se partage entre le doute et l’inquiétude : une forme noire, qui pourrait être un rocher érodé ou une croupe animale, surgit des eaux dans un panorama lacustre crépusculaire. On est très près ici du motif qui inspira à H. P. Lovecraft la dernière et la plus belle de ses nouvelles fantastiques, Night Ocean. Rien de fortuit dans cette référence puisque l’ensemble des autoportraits, à l’instar de la création fantastique littéraire, s’efforce d’atteindre une représentation de l’impossible.
Il est opportun de rappeler à cet endroit que les images de Minkkinen sont issues d’un seul négatif, ce qui les différencie des montages aux effets fantastiques utilisés par certains photographes, comme Jerry Uelsmann par exemple, et ce protocole technique donne un sens extraordinaire au regard que la photographie réfléchit. En effet, pour que le corps du photographe, étranger par définition à ce qu’il voit, puisse ainsi se fondre dans son champ de vision, il faut que le point de vue comprenne l’auteur du point de vue, ce qui est une manière de pousser à l’extrême l’antinomie de l’autoportrait où celui qui voit est aussi celui qui est vu. Il faut aussi que le corps perde une partie de son identité qu’il communique aux êtres inanimés qui l’entourent. Par exemple, dans cette vue magnifique de fjord, Stranda, Norway, 2007 (p. 18), l’impression que la jambe du photographe ajoute un tronc supplémentaire à la rangée de bouleaux du premier plan n’est rendue possible que par une contamination visuelle réciproque du bois et de la chair. Aussi peut-on dire qu’il y a toujours une « chose » à voir dans ces photographies qui n’est ni le paysage, ni l’autoportrait, mais le produit de la fusion qui s’opère entre une partie du corps et son environnement immédiat.
La diversité de l’œuvre de Minkkinen peut alors s’apprécier par les multiples modalités d’apparition de la « chose » qui est le centre d’attraction de chacune de ses photographies. La présence surprenante se manifeste parfois avec un mimétisme plus accentué que dans l’exemple précédent. L’image intitulée Vaisanlansaari, Finland, 1998 (p. 16) ne présente à première vue qu’un sous-bois assez sombre éclairci par l’écorce de quatre bouleaux. On y distingue pourtant un détail insolite : entre les deux arbres du premier plan s’intercalent discrètement un bras et une jambe. Cette ingérence de l’autoportrait ne prend véritablement son sens que par comparaison avec les deux autres troncs, tordus à leur base, comme deux guiboles arrêtées pendant un pas de danse. L’absorption de l’espace naturel par celui de la photographie s’effectue selon une double analogie entre jambe et arbre qui sème le doute au sein de l’ordre naturel, réveillant ainsi les mythologies de forêts magiques.
La métamorphose constitue un mode récurrent d’apparition de la chose à voir. Le cadrage resserré de la photo Kiljava, Finland, 1986, (p. 20) sectionne le corps pour n’en laisser paraître que trois membres agrippés à une branche d’arbre ; cette fragmentation ne semble plus appartenir à un corps humain, mais à un arthropode muni de nombreuses pattes articulées. Dans des séries récentes, c’est le titre donné aux images qui assimile cette métamorphose en lui prêtant métaphoriquement un nom d’animal. Bird of Paltaniemi, Paltaniemi, Kajaani, Finland, 2009, (p. 28) par exemple, baptise « oiseau » le corps incliné devant un lac, assombri par un contrejour, bras écartés prêts à l’envol. Ailleurs, dans un paysage urbain, le titre A Man and His Dog, Mexico, 2007, (p. 52) interprète la forme de l’ombre du corps éclairé dans un passage par le jour d’une arcade.
Les cadrages en miroirs sur des plans d’eau étales produisent des figures de doubles parfois riches de signification symbolique. Une main sort de l’eau, plume en main dans le geste d’écrire, accolée à son double qui en est le reflet symétrique. Dans cette image, Fosters Pond, 2000, (p. 6), le reflet plus foncé juxtapose une écriture de l’ombre à une écriture de lumière en hommage à la photographie. Dans Pimävuori, Finland, 1996 (p. 14), le corps tout entier allongé sur le lac effleure son image symétrique sans même perturber le fil de l’eau, comme en lévitation. Cette suspension impossible retient les différents plans qui concourent à l’avènement de la « chose » : la confrontation sur l’aplat photographique du réel et de son double.
Pour réussir l’infiltration de soi et conduire son spectateur au seuil de l’impossible, Arno Rafael Minkkinen mise sur l’idée courante, ni vraie, ni fausse, selon laquelle la photographie est un double de la réalité visible : aussi la composition de ses cadrages prend en compte la reconstruction du réel à laquelle chacun se livre en regardant une photo. L’inclinaison de ses jambes au-dessus du vide d’un canyon de Lake Powell, (p. 42), donne l’impression que le corps entier qu’on ne voit pas se précipite vertigineusement dans le vide. Des plans fort distants dans la réalité sont rapprochés et superposés sur l’espace de la photographie. Selon ce principe, l’illusion que le photographe pince délicatement la pointe du sein d’une femme peut être produite par un bras tendu au premier plan visé juste au-dessus d’une colline mamelonnée à l’horizon (p. 44). Un même escamotage d’espaces permet à Minkkinen une référence au Bouquet de fleurs de Picasso (affiche de 1958) : ne retenant de cette image que le geste d’arracher, sa main dans la photographie Le Bouquet d’arbres, 2007 (p. 54) semble détacher un bosquet de son ombre frissonnante dans les eaux.
Quand la photographie pervertit les codes de représentation de la réalité en confondant l’espace qu’elle construit avec l’espace perceptif, la réalité attestée ne peut engendrer qu’une atmosphère d’étrangeté. L’œuvre photographique d’Arno Rafael Minkkinen, unique dans l’histoire du médium, est vouée à ce jeu impraticable de places respectives, mais non respectées, entre le sujet qui voit et la chose à voir. Il s’ensuit un régime de visibilité problématique où la vue et le regard, se conjoignant pour devenir l’esprit des lieux, produisent une vision du monde insolite dans laquelle tout peut arriver : une forêt contaminée par l’âme humaine, un androphyte pointant le bout de son orteil, une chose globuleuse se dilatant dans la planéité d’un lac et tant d’autres accidents qui font de cette œuvre l’une des plus surprenantes de l’histoire de la photographie et de ce photographe un poète illusionniste, conciliateur d’espaces impossibles à coordonner.